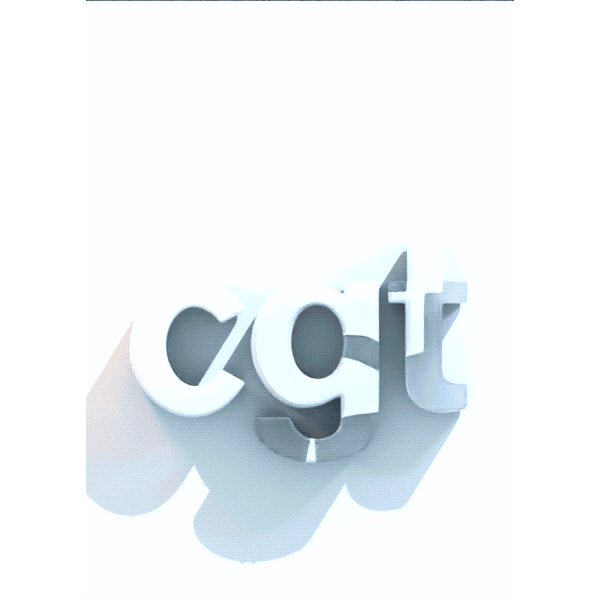MANIFESTE POUR UN SYNDICALISME DE COMBAT DANS LE SECTEUR SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
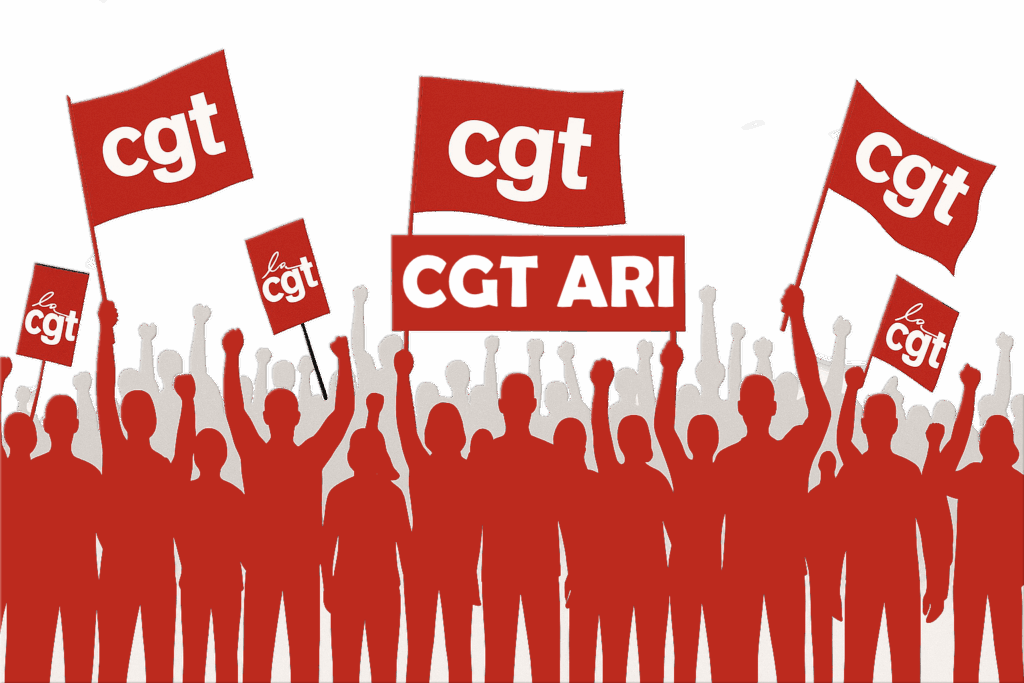
Didier ZIKA | délégué syndical central CGT ARI | 2025
Introduction : Ouvrir le débat pour refonder notre action
Ce texte vise à être un acte de résistance. C’est le refus collectif des professionnels de l’humain d’être les exécutants silencieux de la déshumanisation qu’on leur impose.
Nous sommes les éducateurs, les soignants, les accompagnants. Notre métier, c’est le lien. Le leur, c’est la ligne budgétaire. On nous parle de « bientraitance » tout en organisant méthodiquement la maltraitance institutionnelle par la pénurie.
Cette imposture nous broie. Elle épuise les salariés, abandonne les usagers et dévaste le sens même de notre engagement.
Face à cela, le silence n’est plus une option. Ce manifeste n’est pas un constat d’échec de plus, c’est une contribution politique. Il est conçu comme une base pour ouvrir un débat qui compte : quel syndicalisme CGT devons-nous construire pour le secteur social et médico-social en 2025 ?
Pour répondre, ce texte propose une analyse de notre identité professionnelle et de notre fierté, pour mieux armer la colère légitime que suscite le système gestionnaire. Il réaffirme l’actualité de notre double exigence historique – la dignité au quotidien et un projet de société humaniste. Il explore, enfin, les nouvelles alliances et toute la force de notre intelligence du métier pour gagner.
Ceci est une invitation à la réflexion et à l’action. Un appel à définir toutes et tous ensemble la stratégie de reconquête de notre travail et de notre dignité.
Chapitre 1 : Notre Fierté, Notre Expertise
Nous sommes les visages, les mains et les esprits de la solidarité. Nous sommes les professionnels de ce qui n’a pas de prix mais qui a une valeur inestimable : l’Humain. Dans une société qui fragmente, qui isole et qui mesure tout à l’aune du profit, nous sommes celles et ceux qui rassemblons, qui réparons et qui accompagnons. Nous sommes les éducateurs, les soignants, les psychologues, les moniteurs d’atelier, les veilleurs de nuit, les aides-soignants, les personnels administratifs, techniques et logistiques. Nous formons la chaîne de la République sociale, cette « main gauche de l’État » qui s’efforce selon Pierre Bourdieu, jour après jour, de panser les plaies que sa « main droite », celle de l’économie gestionnaire, ne cesse d’infliger.
Nous sommes cette main gauche lorsque nous accueillons, sans solution, l’adulte handicapé vieillissant que plus aucun établissement n’est en mesure d’accepter, ou cet adolescent dont le handicap psychique et les troubles du comportement qu’il manifeste rend le parcours si chaotique que seule notre expertise collective lui permet d’éviter la rupture définitive.
Notre fierté ne réside pas dans la production de biens matériels, mais dans la reconstruction de parcours de vie, dans la préservation de l’autonomie, dans le soutien à la parentalité, dans l’apaisement de la souffrance psychique et dans la protection des plus vulnérables d’entre nous. Nous sommes les dépositaires de cette « propriété sociale » que Robert Castel définissait comme le bien le plus précieux de notre État-providence : le droit pour chaque citoyen d’être protégé contre les risques de la vie.
Pourtant, cette fierté est quotidiennement mise à l’épreuve par le mépris. On tente de nous réduire à une « vocation », à un don de soi qui devrait se suffire à lui-même et justifier la modestie de nos salaires. C’est un mensonge. Notre engagement n’est pas un sacerdoce ; c’est un travail, et un travail terriblement complexe.
Notre expertise première, celle que l’on tait, celle qui nous épuise et qui n’apparaît dans aucun bilan comptable, c’est le « travail émotionnel » comme le théorise Arlie Russell Hochschild. Ce n’est pas juste un concept abstrait. C’est l’éducatrice qui, pour la troisième fois de la semaine, fait face à un parent en colère, désemparé par l’absence de progrès de son enfant, et qui doit absorber cette colère, la comprendre, la désamorcer et la transformer en une alliance de travail, le tout en gardant un calme professionnel alors qu’elle est elle-même épuisée par le manque d’effectifs. C’est le veilleur de nuit qui passe une heure à apaiser l’angoisse d’un résident désorienté, bien au-delà de la simple « surveillance », parce qu’il sait que cette présence est le seul soin qui vaille à cet instant.
Notre expertise seconde, c’est celle de l’intelligence pratique, du « travail réel ». Face aux protocoles absurdes, aux grilles d’évaluation déshumanisantes et aux injonctions paradoxales d’une administration obsédée par la norme, nous sommes contraints d’inventer, de « tricher » avec le règlement, pour que le « travail bien fait » puisse advenir. Ce « travail réel », ce sont des situations que nous connaissons tous : c’est l’aide-soignante qui, sciemment, choisit de ne pas remplir immédiatement la grille de traçabilité des soins pour passer dix minutes de plus à tenir la main d’une personne en fin de vie, parce qu’elle sait que la dignité prime sur la statistique. C’est le moniteur d’atelier qui bricole un outil inadapté, sur son temps personnel, pour qu’un travailleur d’ESAT retrouve la fierté d’être productif. C’est l’équipe pluridisciplinaire qui décide collectivement de « geler » la rédaction d’un projet personnalisé – pourtant obligatoire – pour se concentrer sur l’urgence d’une crise suicidaire. C’est dans cet écart entre le prescrit et le réel que se loge notre savoir-faire, mais aussi notre souffrance.
Notre expertise enfin, est politique. Elle s’inscrit dans la lignée de ce que les théoriciens du « Care » ont mis en lumière. Prendre soin, comme l’affirme Sandra Laugier, n’est pas une simple disposition morale ou une vertu féminine, mais une activité complète. C’est un travail invisible, souvent dévalorisé, qui exige pourtant une vraie compétence, une attention de tous les instants et une éthique à toute épreuve.
Notre acte politique quotidien, c’est de refuser de réduire un enfant à son « taux de remplissage », ou un adulte handicapé à un « coût journalier ». C’est de refuser la déshumanisation par le chiffre.
Mais ce combat éthique est aussi la base de notre combat syndical. En rendant visible ce travail du « care », en démontrant son indispensabilité au fonctionnement même de la société, notre action syndicale trouve, comme le souligne Laugier, un levier fondamental pour exiger que les pouvoirs publics considèrent enfin ces métiers comme structurants.
Nous ne défendons pas seulement nos emplois et nos salaires ; nous exigeons que le soin, l’éducation spécialisée et l’accompagnement social soient reconnus comme ce qui tient la société debout. Nous exigeons que ces emplois, qui créent du lien et réparent la société, soient intégrés au cœur des stratégies de développement social et non plus relégués au rang de simple « dépense » ou de « charité » institutionnelle.
Notre syndicalisme s’incarne donc dans ce double combat : lorsque nous refusons, en réunion, une orientation par défaut dictée par des contraintes budgétaires, ce n’est pas seulement pour défendre un usager. C’est pour affirmer la valeur politique, économique et fondamentale de notre travail pour toute la société.
Nous ne sommes donc pas un coût. Nous sommes un investissement. Nous ne sommes pas des exécutants dociles. Nous sommes une force de travail qualifiée, pensante et critique. C’est de cette expertise trop souvent niée que naît notre fierté. C’est de cette fierté que naît la légitimité de notre combat syndical.
Chapitre 2 : Notre Colère, Notre Combat
Notre colère n’est pas une fatigue passagère. Elle n’est pas le fruit d’une susceptibilité professionnelle ou d’une résistance au changement. Notre colère est politique, elle est éthique, elle est le symptôme sain d’un corps professionnel qui refuse de se soumettre. Elle est la « souffrance éthique » : la souffrance de celles et ceux contraints par l’organisation du travail à agir en contradiction avec leur déontologie, à faire mal le travail qu’ils savent bien faire, à trahir, en somme, le sens même de leur engagement.
Cette colère a un adversaire précis. Ce n’est pas toujours un directeur malveillant ou un chef de service dépassé ; ceux-là sont souvent les exécutants d’un système qui les broie également. L’adversaire est une idéologie gestionnaire qui a méthodiquement contaminé l’ensemble de l’action sociale, médico-social et sanitaire : le New Public Management. Près de 80 % des employeurs du secteur social anticipent des difficultés de recrutement (DREES, 2022) et un professionnel sur deux estime que son travail a perdu son sens (CEREQ, 2023).
Ce système, importé du secteur privé dans les années 90, prétendait « moderniser » l’État en y appliquant les recettes du marché : la performance, l’évaluation, la concurrence et la rentabilité. Comme l’a disséqué le psychanalyste Roland Gori dans « La Fabrique des imposteurs », ce fut en réalité une offensive contre les métiers. Cette logique a transformé le soignant en « prestataire », le professeur en « performeur » et l’usager en « client ». Dans nos secteurs, elle a imposé une dictature de la quantification.
Nous la vivons au quotidien. C’est l’obsession des « tableaux de bord », des « indicateurs », du « reporting », des « procédures qualité » et de nouveaux métiers comme les « contrôleurs de gestion » qui, sous couvert de transparence, installent une bureaucratie dévorante. C’est le triomphe du « travail mort » – les formulaires, les grilles, les « projets personnalisés » standardisés – sur le « travail vivant » : le temps de la relation, de l’imprévu, de l’écoute. Nous passons désormais plus de temps à prouver que nous travaillons qu’à travailler réellement, générant ce que David Graeber a nommé les « Bullshit Jobs ». Près de la moitié des salariés du médico-social présentent une souffrance psychique significative au cœur même des métiers du soin et plus de neuf soignants sur dix déclarent ressentir une fatigue intense liée à leur travail (DREES, 2024).
Cette logique gestionnaire n’est pas qu’une nuisance administrative ; elle est l’antichambre de la marchandisation. Car si tout peut être mesuré, quantifié et standardisé, tout peut alors être mis en concurrence et devenir une source de profit.
Le scandale Orpea, révélé par l’enquête retentissante de Victor Castanet, « Les Fossoyeurs », n’est pas un accident de parcours. C’est la conséquence logique et monstrueuse de ce système. Quand des grands groupes financiers s’emparent des EHPAD, la vulnérabilité devient une variable d’ajustement. Le rationnement des protections, la nourriture insuffisante, le manque de personnel pour faire face aux besoins les plus élémentaires : voilà le vrai visage de la « performance » financière appliquée à l’humain.
Mais cette marchandisation n’est pas la seule menace. L’État et les collectivités, en adoptant cette même grille de lecture comptable, organisent eux-mêmes ce que nous devons nommer la maltraitance institutionnelle.
La presse ne cesse de s’en faire l’écho, confirmant les alertes des corps d’inspection (IGAS, Cour des comptes) :
- En protection de l’enfance, ce sont les reportages sur ces adolescents de l’Aide Sociale à l’Enfance, faute de places en Maisons d’Enfants, que l’on parque dans des hôtels, livrés à eux-mêmes. Cette gestion par l’urgence et par le « coût le plus bas » les place de facto en danger. Le scandale ultime de cet abandon, ce sont ces jeunes filles mineures, placées sous la responsabilité de l’ASE, qui tombent dans des réseaux de prostitution directement au sein des hôtels où l’institution les a logées. C’est la négation même de notre mission de protection : l’institution censée les protéger de la violence sociale devient, par sa propre défaillance et sa logique comptable, le lieu même de leur exploitation.(En 2023, plus de vingt mille mineurs ont été hébergés à l’hôtel faute de places adaptées, et environ mille d’entre eux ont subi violences ou abus – IGAS, 2023 ; Défenseur des droits, 2024).
- En psychiatrie, et plus encore en pédopsychiatrie, ce sont les listes d’attente qui s’allongent sur plus d’une année dans les Centres Médico-Psychologiques ou les SESSAD, laissant des enfants et des familles sans aucune solution face à une souffrance psychique aiguë.
- Dans le secteur du handicap, c’est l’exil forcé de milliers de nos concitoyens en Belgique, faute de places suffisantes et adaptées en France dans les MAS ou les FAM, faute de financement pour les Instituts Médico-Éducatifs. C’est un abandon organisé par l’État.
Notre combat est donc de briser cette logique mortifère. Notre colère est celle des professionnels qui voient, chaque jour, l’écart se creuser entre la promesse républicaine de solidarité et la réalité d’une gestion qui abandonne les plus fragiles et épuise ceux qui les accompagnent. Notre combat, c’est de refuser que le soin, l’éducation et l’accompagnement soient des marchandises. C’est d’affirmer que la bientraitance a un coût, mais que l’inhumanité a un prix que nous ne sommes plus disposés à payer.
Chapitre 3 : notre double-besogne : la dignité au quotidien, l'humanité pour demain
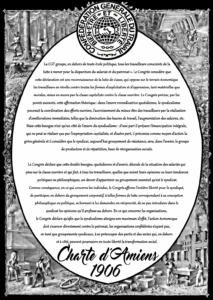 En 1906, lors de son congrès d’Amiens, la CGT (fondée en 1895) a défini ce qui demeure l’essence même de son action. La Charte d’Amiens a gravé dans le marbre l’identité unique du syndicalisme français en lui assignant une « double besogne ». Cet héritage n’est pas un monument que l’on contemple ; c’est un outil de combat que nous réaffûtons. Dans nos métiers du soin, de l’éducation et de l’accompagnement, cette double exigence prend tout son sens. Elle doit être notre boussole.
En 1906, lors de son congrès d’Amiens, la CGT (fondée en 1895) a défini ce qui demeure l’essence même de son action. La Charte d’Amiens a gravé dans le marbre l’identité unique du syndicalisme français en lui assignant une « double besogne ». Cet héritage n’est pas un monument que l’on contemple ; c’est un outil de combat que nous réaffûtons. Dans nos métiers du soin, de l’éducation et de l’accompagnement, cette double exigence prend tout son sens. Elle doit être notre boussole.
Pour nous, à la CGT, la double-besogne n’est pas un concept théorique, c’est l’ADN de notre syndicalisme de lutte. C’est une stratégie à deux temps qui fait de la CGT une organisation irrécupérable par le système.
- Le Poing Levé : La Lutte au Quotidien
La première besogne, c’est le refus de la fatalité. C’est le combat de tous les jours, sur chaque lieu de travail, pour ne rien céder à l’exploitation.
Ce n’est pas une simple « négociation » ; c’est arracher, pied à pied, des augmentations de salaire, des postes, du temps de repos, et le respect de notre dignité. C’est défendre nos acquis et en conquérir de nouveaux. Il faut se rappeler que le salaire médian dans le médico-social reste inférieur de 18 % à celui de la moyenne des agents publics, et 70 % des professionnels déclarent ne pas pouvoir faire correctement leur travail faute de moyens (DREES, 2024 ; ANACT, 2023).
C’est le syndicalisme de résistance, celui qui dit « Non ! » au patronat et aux gouvernements quand ils attaquent nos droits. C’est la construction du rapport de force par la grève, la manifestation, l’action collective. C’est notre bouclier.
- L’Horizon : L’Émancipation Totale
Mais la CGT ne se bat pas pour aménager le capitalisme ou pour obtenir une cage plus dorée (ça c’est la « simple-besogne » des syndicats dits « réformistes »). La seconde besogne, c’est notre projet, notre but : la transformation sociale.
C’est l’objectif final de l’abolition du patronat et du salariat. C’est la conviction que l’exploitation n’est pas négociable, elle doit être éradiquée. C’est la réappropriation collective de l’outil de travail par les travailleurs eux-mêmes.
C’est la construction d’une société juste, débarrassée de l’exploitation de l’homme par l’homme, où l’économie est enfin au service des besoins de tous, et non du profit de quelques-uns. C’est notre épée.
- Le Lien Indissociable
L’un ne va pas sans l’autre.
Sans la lutte quotidienne, notre projet d’émancipation n’est qu’un rêve lointain, une utopie désincarnée. C’est le combat de tous les jours qui construit la conscience de classe, qui unit les salariés et qui nous prépare aux luttes plus larges.
Et sans le projet de transformation sociale, nos luttes quotidiennes ne seraient qu’une course sans fin pour des miettes. Notre horizon révolutionnaire donne un sens politique à chaque revendication.
La double-besogne, c’est refuser d’être de simples gestionnaires de la misère, pour être ceux qui construisent l’alternative.
La Première Exigence : La Dignité au Quotidien (Le combat pour le présent)
Dans le secteur social et médico-social, la première besogne, c’est la lutte pour le présent. C’est le refus de la fatalité. C’est l’œuvre revendicatrice de 1906 traduite dans notre réalité : nous nous battons pour la reconnaissance matérielle et morale de notre travail, ici et maintenant.
Ce combat n’est pas seulement économique, il est une « lutte pour la reconnaissance », pour reprendre le concept d’Axel Honneth. Nous ne quémandons pas, nous exigeons.
Nous exigeons la dignité salariale. Notre combat, nous l’avons mené pour les « oubliés du Ségur ». Environ 40 % des personnels du secteur social associatif ont été exclus des revalorisations du Ségur, avec un écart moyen de rémunération de 300 € nets mensuels selon la source de financement (Ministère des Solidarités, 2023 ; CGT Santé et Action Sociale, 2023). C’est cette injustice flagrante où des collègues, travaillant dans le même établissement, sous la même convention, mais financés par des lignes budgétaires différentes, sont exclus des revalorisations accordées à d’autres. C’est le refus d’un salaire qui nous maintient dans la précarité alors que nous prenons soin des plus précaires.
Nous exigeons la dignité de nos conditions de travail. Cette lutte, c’est le combat quotidien contre la « gestion à flux tendu ». C’est le refus de l’absurdité des ratios intenables, comme en EHPAD, où une seule aide-soignante doit prendre en charge la toilette et le lever de dix résidents en moins de deux heures. C’est le combat de l’éducateur en MECS qui doit gérer seul un groupe d’adolescents en crise aiguë, faute de personnel. C’est, comme l’a démontré Christophe Dejours, une défense de notre santé mentale et physique contre une organisation du travail pathogène qui nous pousse à l’épuisement professionnel.
Nous exigeons la dignité de notre expertise. Cette lutte, c’est le refus de la déqualification organisée. C’est le combat contre le remplacement systématique des professionnels diplômés (AMP, éducateurs spécialisés, infirmiers, psychologues) par des « faisant-fonction » moins payés, moins formés, et que l’on jette sans soutien face à des situations d’une complexité extrême. C’est affirmer que nos diplômes ne sont pas des suggestions administratives, mais la garantie de la bientraitance. Plus de 60 % des salariés du social travaillent régulièrement en sous-effectif et 54 % déclarent que leur charge émotionnelle est « au-delà du supportable » (DREES, 2023 ; CNAM-TS, 2024).
Cette première besogne est une lutte de résistance. C’est le « non » que nous opposons chaque jour à la dégradation. Mais la CGT ne sait pas seulement dire non.
La Seconde Exigence : L’Humanité pour Demain (Le combat pour l’avenir)
La seconde besogne de la Charte d’Amiens, c’est l’émancipation, l’expropriation capitaliste. Pour nous, en 2025, l’objectif final n’est pas de prendre le contrôle des usines, mais de libérer l’humain de la sphère marchande. C’est l’expropriation des logiques financières qui ont pris le soin en otage.
Notre projet de société, c’est de faire de l’accompagnement de la vulnérabilité (handicap, grand âge, enfance en danger, exclusion) un « bien commun ». Comme l’ont théorisé Pierre Dardot et Christian Laval, le « commun » est ce qui ne doit relever ni de la propriété de l’État, ni de celle du marché, mais qui doit être gouverné par ceux qui en font l’usage et ceux qui le produisent.
Notre vision est celle d’un Grand Service Public de l’Autonomie et de l’Accompagnement, soustrait aux appétits financiers.
Cela signifie, concrètement, la « dé-financiarisation » du secteur. Le scandale Orpea nous l’a appris : l’argent public doit financer le soin, pas les dividendes. Notre exigence est claire : zéro euro d’argent public pour les actionnaires. Nous militons pour que les structures lucratives soient exclues du champ de l’accompagnement humain financé par la solidarité nationale ou, a minima, contraintes par des règles strictes. En effet, il faut savoir qu’un euro sur quatre des financements publics de la dépendance finit dans des structures à but lucratif, et en 2022 les dix premiers groupes privés du secteur ont cumulé plus de 700 millions d’euros de bénéfices (Cour des Comptes, 2023 ; Observatoire des Multinationales, 2024)
Cela signifie, concrètement, une révolution de la gouvernance. L’émancipation de 1906, c’était le « syndicat, groupement de production ». C’est l’émancipation du secteur social et médico-social de 2025, c’est le salarié et l’usager, co-décisionnaires de l’organisation du soin. Nous revendiquons que les représentants du personnel (CGT) et les représentants des usagers et des familles aient un droit de regard et de veto dans les conseils d’administration sur toutes les décisions impactant la qualité de l’accompagnement et l’allocation des budgets. C’est la fin du pouvoir solitaire des gestionnaires.
Les deux besognes sont indissociables. C’est parce que nous nous battons pour un poste supplémentaire aujourd’hui (Besogne 1) que nous posons les bases d’un service public digne demain (Besogne 2). C’est parce que nous avons un projet de transformation sociale (Besogne 2) que notre lutte pour les salaires (Besogne 1) prend tout son sens : elle n’est pas une simple revendication catégorielle, elle est la première étape de la réappropriation de notre travail.
Chapitre 4 : Notre Outil : Un Syndicat Démocratique, Indépendant et Inclusif
Face à un système qui nous broie, la fierté ne suffit pas. Face à une colère si profonde, l’indignation ne suffit plus. Pour porter la double exigence et pour construire l’alliance de l’intelligence collective, il nous faut un outil. Cet outil, c’est notre bien commun, c’est l’organisation de notre force : c’est le syndicat CGT. Mais il ne peut être cet outil qu’à trois conditions non négociables, qui forment son identité même.
L’Indépendance Fondatrice
Notre ADN, notre point de départ, est l’héritage de la Charte d’Amiens. L’indépendance de la CGT n’est pas un principe négociable, c’est la condition de notre existence.
C’est d’abord, et toujours, l’indépendance vis-à-vis des partis politiques, des gouvernements et des sectes religieuses. La CGT n’est la « courroie de transmission » de personne ; il existe d’autres syndicats qui se complaisent dans cette fonction. A la CGT, ce sont les salariés, en assemblée, qui décident de notre orientation, de nos revendications et de nos actions. Nous ne recevons d’ordres ni de l’État, ni d’aucun parti.
Mais en 2025, dans nos secteurs, cette indépendance prend un sens nouveau et essentiel. C’est aussi l’indépendance absolue vis-à-vis de l’idéologie gestionnaire. Notre syndicalisme doit refuser de devenir un « partenaire social » dont le seul rôle serait de co-gérer la pénurie et d’organiser la régression. Nous ne sommes pas des facilitateurs de la maltraitance institutionnelle, nous en sommes le contre-pouvoir. Nous refusons de signer les protocoles qui dégradent nos métiers, même au nom du « réalisme économique ». Notre réalisme, c’est celui du « travail réel », celui de l’éthique du soin.
La Démocratie Vivante
Notre syndicat n’est pas une administration de services. La CGT n’est pas une entité extérieure à laquelle on « s’abonne » pour obtenir une protection juridique. Notre syndicat, c’est l’auto-organisation des salariés. Il est ce que nous en faisons.
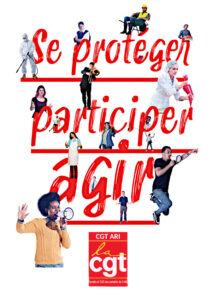
Sa vitalité repose sur la démocratie de base : c’est le syndicat de l’Heure d’Information Syndicale, de l’Assemblée Générale où la parole de l’agent de service pèse autant que celle du chef de service, où le CDD a le même droit à la parole que le CDI. C’est le lieu où l’on ne parle pas pour les salariés, mais où les salariés parlent.
C’est un syndicalisme d’adhérents, où chaque membre est une force de proposition et d’action. C’est cette démocratie interne, parfois tumultueuse mais toujours vivante, qui nous protège de la bureaucratisation. C’est elle qui garantit que le syndicat reste l’outil des salariés, et non une fin en soi. C’est cette transparence et ce fonctionnement démocratique qui doivent attirer les nouvelles générations, fatiguées des structures verticales et qui exigent la cohérence entre nos paroles et nos actes.
L’Inclusion en Acte
Enfin, notre syndicat est un syndicat de lutte des classes. Et la lutte des classes, aujourd’hui, c’est comprendre que le capitalisme prospère en nous divisant. L’inclusion n’est pas un supplément d’âme moral ; c’est une nécessité stratégique.
Le patronat divise : il oppose les « diplômés » aux « faisant-fonction » pour tirer tous les salaires vers le bas. Il oppose les précaires aux statutaires. Il s’appuie sur la division sexuelle du travail : comme l’a analysé la sociologue Danièle Kergoat, ce n’est pas un hasard si nos métiers du care sont massivement féminisés, dévalorisés et sous-payés. Le mépris du « travail de femme » est un outil direct de l’exploitation capitaliste.
Près de neuf professionnels sur dix dans le secteur social et médico-social sont des femmes (DREES, 2023). Ces métiers du « care » représentent environ 1,7 million d’emplois en France, mais demeurent parmi les moins reconnus. Par conséquent, notre syndicalisme est structurellement féministe, car se battre pour le salaire des AES, des aides-soignantes ou des infirmières, c’est briser cette division de genre. Notre syndicalisme est antiraciste, car il refuse que les tâches les plus dures soient systématiquement assignées aux salariés perçus comme « étrangers ». Notre syndicalisme combat la précarité en exigeant la titularisation des CDD, non par charité, mais parce qu’un collègue précaire est un collègue muselé, affaiblissant l’ensemble de notre collectif.
Le syndicat CGT est le lieu où ces luttes convergent. Il est le creuset où l’agent d’entretien, l’éducateur, la psychologue, le moniteur d’atelier et la secrétaire comprennent qu’ils subissent, sous des formes différentes, la même logique d’exploitation, et qu’ils ne peuvent y répondre que par une solidarité de classe à toute épreuve. Indépendant, démocratique et inclusif, le syndicat est l’arme que nous nous donnons pour reconquérir notre fierté, transformer notre colère, et gagner notre double exigence.
Chapitre 5 : Notre Force : L'Alliance et l'Intelligence Collective
Si notre colère est notre moteur et notre double exigence notre boussole, notre force réside dans notre capacité à briser l’isolement et à transformer notre expertise en arme de combat. Le pouvoir gestionnaire et financier, que nous avons décrit, ne prospère que sur le silence, la division et notre épuisement à compenser ses propres défaillances. Notre stratégie doit donc être celle de la convergence et de l’intelligence.
Héritiers de la Charte d’Amiens, nous ne renonçons à aucun de nos outils de lutte. La grève demeure le droit fondamental des travailleurs, l’arme ultime du rapport de force, la suspension collective du travail qui démontre qui crée réellement la valeur. Mais nous sommes lucides. Dans nos métiers de l’humain, la grève est un crève-cœur. Elle est rendue éthiquement complexe par la vulnérabilité des personnes que nous accompagnons et stratégiquement affaiblie par les réquisitions et les assignations abusives. Le pouvoir le sait et en joue, nous enfermant dans un dilemme moral. C’est pourquoi la grève ne peut plus être notre seul recours ; elle doit être l’aboutissement d’une stratégie plus large.
Notre première force, c’est notre intelligence collective du travail. C’est le « travail réel » que nous avons décrit. L’administration, dans son obsession du contrôle, a créé une « langue de bois » gestionnaire, celle des protocoles, des normes ISO et des évaluations déconnectées. Comme l’a analysé le sociologue Alain Supiot, nous subissons une « gouvernance par les nombres » qui prétend remplacer le jugement professionnel par le calcul. Notre premier acte de résistance est de refuser ce dessaisissement.
Nous devons repolitiser notre expertise technique. Notre force, c’est de cesser d’être les « bons petits soldats » qui pallient les manques. C’est d’arrêter d’utiliser notre intelligence à faire fonctionner le système malgré tout. Cela commence par ce que l’on pourrait nommer la « grève du zèle éthique » : non pas cesser le travail, mais cesser de mal le faire. C’est refuser de signer un projet personnalisé rédigé dans l’urgence. C’est tracer méticuleusement chaque manquement à la sécurité pour créer la preuve de la défaillance. Mais cela doit aller plus loin. Nous devons inventer nos propres formes de lutte. Pourquoi ne pas organiser la grève du « reporting », en cessant de nourrir la machine administrative par nos indicateurs, pour libérer ce temps au profit du soin ? Pourquoi ne pas retourner leurs propres outils « qualité » contre eux, en produisant nos propres contre-audits critiques ? C’est l’arme de l’intelligence qui retourne la bureaucratie contre elle-même, pour la forcer à se confronter au réel.
Mais cette intelligence collective ne suffit pas si elle reste isolée. Notre véritable force doit devenir l’alliance avec les usagers et leurs familles. Nous le savons, cette convergence n’est ni naturelle ni spontanée, car le système fait tout pour l’empêcher.
Ce pouvoir gestionnaire, véritable « biopouvoir » analysé par Michel Foucault, ne se contente pas de réprimer : il administre, il classe et il gère la vie elle-même. En nous assignant, usagers comme salariés, à des statuts, des protocoles et des budgets distincts, il nous gouverne en nous séparant. C’est ainsi qu’il monte les familles, épuisées par le manque de solutions et les listes d’attente, contre des soignants « jamais disponibles ». C’est ainsi qu’il épuise les soignants, écrasés par le manque de moyens, qui finissent par voir les familles comme une source de pression supplémentaire.
Briser ce piège de la division est l’enjeu principal de notre lutte. Notre combat ne peut être victorieux s’il reste corporatiste. Il doit devenir un combat citoyen pour la dignité partagée.
La CGT doit donc rechercher activement et méthodiquement la coopération avec les collectifs d’usagers, les associations de parents et les familles. Nous devons construire patiemment les conditions de ce « front du care ».
Concrètement, cela signifie que le syndicat CGT doit s’atteler à être le catalyseur de cette alliance. Notre volonté est de transformer la nature même de nos luttes : lorsque nous dénonçons un manque d’effectifs, nous devons le faire au nom de la sécurité et de la bientraitance des usagers. Lorsque nous rédigeons un tract, nous devons arriver à ce qu’il soit co-signé par les collectifs de familles. Lorsque nous demandons une audience à l’Agence Régionale de Santé ou au Conseil Départemental, nous devons inviter les représentants d’usagers à se joindre à nous pour porter une voix commune.
Cette alliance n’est pas un simple supplément d’âme ; c’est la condition de notre victoire. C’est elle, et elle seule, qui transformera une revendication sectorielle, si juste soit-elle, en une exigence de société qui s’impose au pouvoir politique.
Enfin, notre force réside dans l’utilisation de tous les leviers de l’État de droit. Nous devons devenir des « lanceurs d’alerte » juridiques et médiatiques. Le scandale Orpea, c’est la CGT et les salariés qui l’ont dénoncé bien avant les journalistes, mais sans être entendus. Nous devons systématiser ces alertes.
Notre action syndicale doit se doubler d’une action juridique offensive : utiliser le droit d’alerte pour danger grave et imminent, attaquer les budgets insuffisants et les décisions de tarification devant le Tribunal Administratif, documenter chaque cas de maltraitance institutionnelle pour nourrir des actions en justice. Comme l’a montré la philosophe Cynthia Fleury, le courage de la vérité et l’exigence de l’État de droit sont les premiers remparts contre la déshumanisation. Notre force, c’est d’utiliser la loi pour imposer le respect de l’éthique.
L’alliance avec les usagers, l’offensive juridique et l’intelligence de notre expertise sont nos points d’appui. Mais l’arsenal de la CGT pour le XXIe siècle reste à inventer, et il ne peut être inventé qu’ici, sur le terrain, par nous. Ce chapitre n’est donc pas une conclusion, mais une ouverture. Il est un appel à notre intelligence collective pour débattre, imaginer et mettre en œuvre les nouvelles formes d’action – occupations éthiques, interpellations publiques, grèves administratives – capables de gagner le combat pour la dignité. Ouvrons ce débat !
Conclusion
Tout au long de ce texte, nous l’avons martelé : la CGT s’est construite sur une double-besogne, et c’est cette stratégie qui, aujourd’hui encore, doit armer notre combat. Nous lui avons donné ici un visage concret, celui de nos métiers, celui de notre secteur.
La première besogne, c’est le front de la résistance quotidienne. C’est la lutte pour la dignité salariale, pour la reconnaissance de nos qualifications, pour des effectifs qui nous permettent de travailler sans nous épuiser. C’est le « non » que nous opposons chaque jour à la dégradation, le bouclier qui protège notre santé et les conditions de la bientraitance. C’est le combat pour ne plus seulement survivre, mais pour vivre de notre travail.
Mais cette résistance serait vaine si elle n’était pas portée par un projet, par une vision. C’est notre seconde besogne, celle qui donne un sens politique à la première : l’offensive pour libérer l’humain de la logique marchande. Notre projet, c’est la conquête d’un véritable Service Public de l’Autonomie et de l’Accompagnement, financé par la solidarité et gouverné par les salariés et les usagers. L’une est le chemin, l’autre est la destination. L’une sans l’autre est une impasse.
Nous avons fait le bilan. Nous avons mis les mots sur ce qu’ils font de notre travail, sur ce qu’ils font de nos vies. Nous avons décortiqué la fierté de nos métiers, cette expertise qu’ils méprisent. Nous avons analysé la machine à broyer, cette machine gestionnaire qui n’est que le bras armé d’une seule logique : celle du Capital.
Ce que nous combattons, ce n’est pas une simple « mauvaise gestion ». C’est l’offensive de la finance qui veut faire du profit sur tout. Sur nos vieux, sur nos enfants en difficulté, sur le handicap. Pour eux, un usager est un coût, un salarié est un coût. Leur seul objectif, c’est la rentabilité.
Et ce que nous vivons dans le social et le médico-social, ne croyez pas que c’est isolé. C’est exactement la même guerre que celle qu’ils mènent contre le raffineur, contre le cheminot, contre l’électricien ou contre le prof. C’est la même logique qui casse l’hôpital public, qui démantèle le fret ferroviaire et qui attaque nos retraites.
Ils nous attaquent secteur par secteur, ils nous divisent pour mieux régner. Ils veulent nous faire croire que nos problèmes sont uniques pour empêcher ce qu’ils craignent le plus : la convergence de nos luttes.
Alors la question, elle est simple. Nous continuons à nous battre chacun dans notre coin, établissement par établissement, pendant qu’eux avancent en front uni ? Nous continuons à pleurer sur la pénurie organisée, ou nous décidons de bloquer la machine ?
Le patronat, le MEDEF et ce gouvernement est à leur service ne comprennent qu’une seule langue. Ce n’est pas celle de la négociation polie. C’est celle du rapport de force.
Et le rapport de force ne se construit pas en gérant la misère. Le rapport de force se construit dans l’action, par la grève, en préparant l’offensive, en même temps, public comme privé.
Notre outil pour ça, pour refuser cette société de l’exploitation, c’est la CGT. Pas la CGT qui accompagne, mais la CGT qui combat. La CGT qui ne craint pas de nommer l’ennemi et de construire la lutte des classes.
L’heure n’est plus à la défense de nos acquis. L’heure est à la contre-offensive générale.
Ne restez pas seuls face à la direction. Ne laissez pas votre colère s’évaporer. Transformez-la en force collective. La seule place qui vaille aujourd’hui, c’est celle du combat.
Organisons-nous. Syndiquons-nous. Rejoignons la CGT. Préparons la riposte d’ensemble. C’est tous ensemble, et seulement tous ensemble, qu’on les fera plier.

Au sujet de l’auteur :

Educateur spécialisé depuis 13 ans à l’ARI, Didier Zika partage son activité entre le DITEP Le Verdier à Martigues et son engagement syndical. Il est délégué syndical central de la CGT de l’ARI et secrétaire général du syndicat.
Sources bibliographiques :
- Bourdieu, P. (1993). La Misère du monde. Paris : Seuil.
- Bourdieu, P. (2012). Sur l’État. Cours au Collège de France (1989-1992). Paris : Seuil.
- Castanet, V. (2022). Les Fossoyeurs. Paris : Fayard.
- Castel, R. (1995). Les Métamorphoses de la question sociale : une chronique du salariat. Paris : Fayard.
- CEREQ. (2023). Sens du travail et engagement professionnel.
- Cour des Comptes. (2023). Rapport sur le secteur du grand âge.
- Cour des Comptes. (2023). Rapport sur le financement du secteur médico-social.
- CNAM-TS. (2024). Observatoire de la santé au travail.
- Dardot, P., & Laval, C. (2014). Commun : Essai sur la révolution au XXIe siècle. Paris : La Découverte.
- Dejours, C. (1998). Souffrance en France : La banalisation de l’injustice sociale. Paris : Seuil.
- DREES. (2022). Baromètre des tensions de recrutement dans le travail social.
- DREES. (2023). Conditions de travail dans les métiers de la relation.
- DREES. (2024). Conditions de travail et santé des professionnels du médico-social.
- Fleury, C. (2010). La Fin du courage. Editions Fayard.
- Foucault, M. (1976). Il faut défendre la société. Paris : Gallimard / Seuil.
- Foucault, M. (2004). Naissance de la biopolitique. Paris : Gallimard / Seuil.
- Gori, R. (2013). La Fabrique des imposteurs. Paris : Les Liens qui Libèrent.
- Graeber, D. (2018). Bullshit Jobs : un travail de merde. Paris : Les Liens qui Libèrent.
- Honneth, A. (2000). La Lutte pour la reconnaissance. Paris : Cerf.
- IGAS. (2023). Rapport sur la protection de l’enfance.
- Kergoat, D. (2012). Se battre, disent-elles…. Paris : La Dispute.
- Laugier, S., Paperman, P., & Molinier, P. (dir.) (2009). Le souci des autres. Paris : Éditions de l’EHESS.
- Laugier, S. (2011). Politique du care. Paris : La Découverte.
- Ministère des Solidarités. (2023). Évaluation du Ségur dans le secteur social et médico-social.
- Observatoire des Multinationales. (2024). Enquête sur la financiarisation du grand âge.
- Russell Hochschild, A. (1983, trad. 2017), Le Prix des sentiments. Au cœur du travail émotionnel Paris : La Découverte.
- Supiot, A. (2015). La Gouvernance par les nombres. Paris : Fayard.
- Fédération CGT Santé et Action Sociale. (2023). Bilan des effets du Ségur de la Santé.