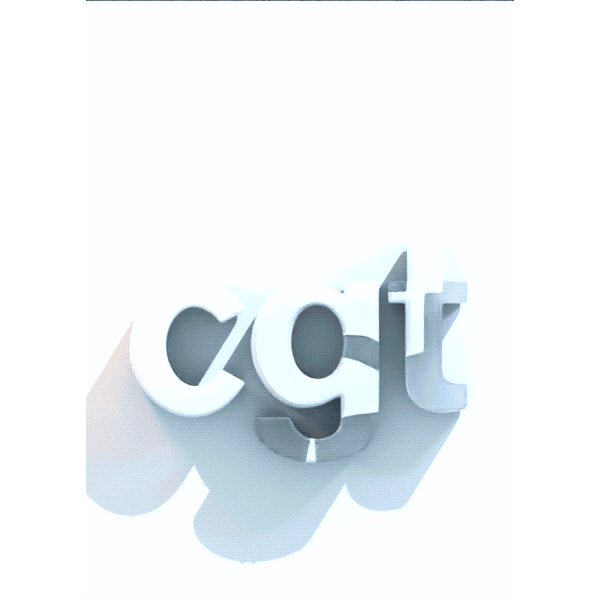Le secret professionnel et l’injonction en ESMS
INTRODUCTION

a) Le secret professionnel
La CGT de l’ARI est souvent sollicitée par des collègues (non-cadres, cadres, chefs d’équipes ou médecins) qui se posent des questions sur le secret professionnel, le secret partagé et le secret médical.
La question avait fait débat il y a quelques années grâce aux assistantes sociales qui, s’appuyant sur le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), se réservaient le droit de ne pas tout partager en équipe. De même, les rapports avec l’école étaient complexes et le statut de la confidentialité des prises en charge en ESS, elle aussi, interrogeait.
Plus récemment, l’arrivée du RGPD et la dématérialisation du dossier ont modernisé ces interrogations : Qui peut consulter les comptes-rendus ? A qui sont-ils télétransmis ? A quelles fins ? Pour combien de temps ? La traçabilité des consultations de dossiers semble pourtant requise par la CNIL (relayée par la HAS : notion de « bris de glace ») y compris entre membres d’une même équipe.
Encore plus récemment, (juste avant les vacances d’été), lors d‘une évaluation externe, des experts ont expressément demandé si les non-médecins pouvaient consulter les informations médicales des dossiers : les préconisations de l’HAS (Haute Autorité de Santé) iraient-elles dans le sens d’une stricte séparation ?
Face à ces interrogations, les « chefs » ont des réponses diverses, parfois argumentées, parfois contradictoires, parfois péremptoires, voire autoritaires.
La CGT de l’ARI, fidèle à sa vocation d’information et de conscientisation de TOUS les salariés, produit donc ce document informatif afin que tous aient accès à la même information loin des rumeurs, des « on a toujours fait comme ça » ou des « c’est comme ça qui faut faire ! » un peu secs.
b) L’injonction abusive
Concomitant aux interrogations sur le secret professionnel, la CGT de l’ARI a constaté, ces dernières années, une augmentation de témoignages sur ce qui semble être des violations de l’autonomie professionnelle et de la déontologie (essentiellement en ITEP et en CMPP) notamment vis-à-vis des psychologues.
Au cours d’un échange informel avec la direction, il nous a aussi semblé que la direction générale partait du principe qu’un psychologue doit obéir lorsqu’un directeur, un chef de service ou un médecin responsable demande d’arrêter une prise en charge individuelle (la CGT de l’ARI nuance cette idée).
De même, comment réagir lorsqu’un cadre hiérarchique intime l’ordre à un professionnel de modifier un compte-rendu ? L’injonction a-t-elle la même portée lorsqu’elle est émise par un médecin responsable du soin et de la prise en charge ?
Loin de vouloir trancher défensivement, la CGT de l’ARI entend, par cet article, clarifier les grands principes généraux et ce qu’il n’est pas possible d’imposer aux professionnels.
La CGT de l’ARI rappelle ici, que les droits des professionnels en ESMS sont toujours au bénéfice des personnes accueillies.
N’en déplaise à certains de nos cadres dirigeants.
PARTIE 1 : Le « secret médical » - déconstruction d'un concept flou
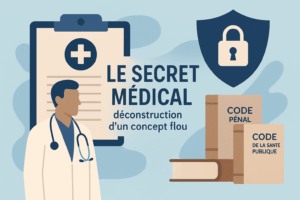
a) La base : Code Pénal et Code de la Santé Publique…
Le Code Pénal[1] précise que la révélation d’une information à caractère secret par une personne tenue au secret professionnel est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (toutes professions confondues).
Le Code de la Santé Publique[2] quant à lui, indique que toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement, un service, un professionnel relavant du social ou du médico‑social a le droit au respect de sa vie privée et au secret des informations le concernant. Ce secret couvre l’ensemble des informations connues ou comprises[3] par les intervenants et s’impose à tous les professionnels intervenants.
Néanmoins, le partage des informations est possible. Mais il ne peut s’effectuer qu’avec une double contrainte[4] :
- Stricte nécessité : uniquement les informations nécessaires à la coordination, à la continuité des soins, à la prévention ou au suivi médico-social.
- Périmètre de la mission : chaque professionnel n’accède et ne partage que dans le cadre de sa mission auprès de la personne.
b) Les droits fondamentaux : RGPD & CNIL
Pour rappel, la CNIL et le RGPD concernent toutes les données. Qu’elles soient sous forme de documents papiers « structurés » ou dématérialisées[5].
L’article 5.c. du RPGD[6] et la CNIL imposent des droits d’accès profilés où les professionnels n’accèdent qu’aux données dont ils ont besoin. Des accès trop larges aux dossiers patients sont régulièrement pointés, notamment dans les hôpitaux. La traçabilité des accès et le cloisonnement sont recommandés[7].
Là encore, les professionnels ou les logiciels qu’ils utilisent sont tenus de ne pas tout partager et surtout pas sans discernement.
c) Cas particuliers : les « notes personnelles »
Les « notes personnelles » sont tenues à part. Elles sont non-partagées et n’ont pas vocation à être communiquées. Le RGPD (et le bon sens) implique qu’elles soient détruites lorsqu’elles ne servent plus (fin de prise en charge ou fin du risque de litige).
Deux cas particuliers sont à distinguer :
- Les médecins obéissent à leur déontologie les concernant[8] (elles peuvent éventuellement être transmises de médecin à médecin pour la continuité des soins mais elles sont alors versées au dossier et en deviennent une partie).
- En 2013, les notes personnelles d’un psychologue ont finalement été versées au dossier médical d’une patiente[9]. Elles ont alors été traitées comme le reste du dossier.
d) Secret médical : clarifications
Le secret médical n’est mentionné dans l’article L1110-4 du CSP que pour les situations de diagnostic ou de pronostic grave ou post-décès. Dans les deux premiers cas, seul le médecin est habilité à transmettre des informations nécessaires à la famille ou aux proches.
Il faut donc garder en tête que le « secret médical » n’est pas un régime distinct du secret professionnel mentionné dans l’article du code pénal. Il n’est qu’une déclinaison terminologique de ce même secret professionnel lorsqu’il s’agit de médecins et/ou d’informations de santé.
Il n’existe donc pas de secret médical distinct du secret professionnel, il s’agit seulement d’une appellation différente. Il n’en demeure pas moins que les médecins ont, vis-à-vis de ce secret professionnel (nommé « secret médical ») des obligations déontologiques propres à leur profession[10].
Il n’existe donc pas de régime législatif distinct entre les deux termes. Le secret médical est le secret professionnel, il s’agit seulement d’une altération lexicale lorsqu’il est question de médecin ou d’informations médicales.
e) Résumé : le secret professionnel en bref et en pratique
Hors-Équipe : Lorsqu’un professionnel veut communiquer hors-équipe (avec un autre service, par exemple), le consentement de la personne est obligatoire[11].
Même Équipe : Au sein d’une même équipe[12], on partage et on échange ce qui est nécessaire. Néanmoins, la personne doit[13] être informée de son droit d’opposition. C’est-à-dire qu’elle peut décider qu’une information donnée à un professionnel peut ne pas être transmise au reste de l’équipe. La personne peut changer d’avis et exercer ce droit à tout moment[14].
Être dépositaire d’un secret dans une même équipe ne donne pas le droit de tout savoir, que ces informations soient éducatives, psychologiques, médicales, orthophoniques, etc. Pour le coup, il n’y a pas de spécificité de l’information « médicale ». Mais empêcher des psychologues, éducateurs, orthophonistes ou psychomotriciens d’une même équipe, d’avoir accès à des données médicales utiles à leur travail n’est pas conforme à la loi ni à l’esprit de la loi.
_________________________
[1] Article 226-13
[2] Article L1110-4
[3] Cela inclut les spéculations.
[4] Code Santé Publique (R1110-1 à R1110-3)
[5] Pour les Dossiers Patients informatisés (DPI), il existe des référentiels issus de l’ANS (Agence du Numérique en Santé) comme le PGSSI-S pour le secteur sanitaire, médico-social et social. Ces référentiels contraignants et opposables : incluent le respect des RGPD et du Code de la Santé Publique.
[6] « Article 5 – Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel ; 1) Les données à caractère personnel doivent être : […] c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données); »
[7] 13 Mise en demeure d’établissements de santé entre 2020 et 2024 : « […] les mesures de sécurité informatique et la politique de gestion des habilitations étaient parfois inadaptées aux besoins des établissements, en permettant notamment à des professionnels de santé ne participant pas à la prise en charge du patient d’accéder à des informations relatives à ce dernier. »
[8] Article R4127-45 du CSP.
[9] TA d’Amiens, 24 octobre 2013, n° 1200264.
[10] Les médecins sont tenus au secret professionnel par leur code de déontologie. Ce code de déontologie présente la particularité d’être inscrit sous forme d’article dans le Code de la Santé Publique (Articles R4127-1 à R4127-112). C’est précisément ce code de déontologie qui utilise le terme de « secret médical ».
[11] Code Santé Publique (L1110-4 III)
[12] Code Santé Publique (Voir L1110-12 pour la définition d’une « même équipe de soins »)
[13] Pour qu’un droit puisse être exercé, il faut, avant tout, que les personnes sachent qu’il existe. Code Santé Publique (L1110-4 IV : « La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. »)
[14] « Je ne veux pas que l’orthophoniste sache que ma fille a encore la sucette… », « j’étais sous héroïne pendant ma grossesse mais je veux que ça reste entre nous. Ne le dites surtout pas au psychiatre » sont donc des refus de partage d’information à l’intérieur d’une même équipe de la part des personnes accueillies et sont donc… à respecter.
PARTIE 2 : L'école - les ESS et le secret professionnel
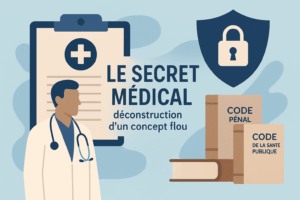
a) L’école : ESS[1] et MDPH
En ESS, les professionnels de CAMSP, CMPP ou ITEP sont souvent encouragés à s’exprimer sur l’état de santé, physique ou psychique, de l’enfant ou de la famille ou le diagnostic. Parfois avec beaucoup d’insistance de la part de l’école.
Il est vrai que l’école est un partenaire essentiel du mieux-être de l’enfant. Elle est, d’ailleurs, parfois elle-même à l’origine de la démarche qui a amené la famille en CAMSP, CMPP ou à l’ITEP. Comment, dans ce cas, lui refuser la moindre information ?
Pourtant en pratique l’école n’est pas à la même place que les autres partenaires. Même si tous les membres d’une ESS sont, eux-aussi, soumis au secret professionnel, d’un point de vue juridique, l’école n’est pas une « équipe de soins » au sens du Code de la Santé Publique[2].
Au sens de l’article L1110-4 du CSP, le consentement pour échanger avec l’école est obligatoire et doit se limiter au strict nécessaire utile au PPS ou à l’accueil de l’élève[3].
b) Transmettre à l’école : le cas des comptes-rendus / bilans
En pratique, les équipes de soins (médico-sociales ou pas) ne transmettent pas directement aux écoles de comptes-rendus mais cela serait possible : si uniquement ces comptes-rendus étaient réputés utiles au PPS et avec l’accord explicite des titulaires de l’autorité parentale[4].
Si une équipe était amenée à le faire, il conviendrait d’apporter un soin tout particulier afin de censurer les informations issues de l’anamnèse et de procéder à la minimisation des données (au sens du RGPD).
L’Éducation nationale précise que les données de santé des élèves ne doivent être communiquées qu’aux services de santé de l’éducation nationale (infirmiers scolaire ou médecins) et qu’« en aucun cas, ces renseignements ne pourront préciser la nature du handicap ou de la pathologie. »[5]. La présence d’une AESH ou d’une notification MDPH ne change rien à l’affaire.
c) Transmettre des bilans : le cas du non médical
Les professionnels des équipes qui ne sont ni médicaux ni paramédicaux (psychologues et éducateurs, par exemple) pourraient se demander si un compte-rendu éducatif ou un WISC (par exemple) doit être considéré comme des données de santé.
Au sens du RGPD (relayé par l’ANS)[6] ces documents renseignent sur l’état physique ou mental d’un enfant et sont des données de santé qui doivent être traités comme telles.
Dans ce cas particulier, s’il est nécessaire de transmettre un compte-rendu/bilan, le psychologue de l’Éducation Nationale pourra également recevoir (avec le consentement des détenteurs de l’autorité parentale) une synthèse (expurgée des éléments mentionnés au chapitre précédent) et contenant seulement les éléments utiles à la scolarisation.
___________________________
[1] ESS : Equipe de Suivi de Scolarisation
[2] CSP L11110-12
[3] Par exemple, formuler les besoins et aménagements : conseils, contre-indications, situations contre-productives, sensorialité, disposition dans la classe, calme, recommandations pour les interventions des AESH, etc.
[4] « L’information sur la prise en charge dans une structure de soins contenue dans un traitement constitue une donnée de santé, dès lors qu’elle donne une indication sur l’état de santé (ex : admission dans un établissement ou service hospitalier spécialisé). » https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante
[5] La CGT de l’ARI rappelle qu’il est essentiel que ce consentement ait été formalisé et soit versé au dossier. Ce consentement est systématiquement recherché par les experts lors des évaluations externes.
[6] Les données de santé concernant les élèves
Le traitement de données relatives à la santé des élèves est autorisé mais limité à certains cas, les données nécessaires à une prise en charge spécifique des élèves à besoins particuliers dans le cadre du :
-
projet d’accueil individualisé (PAI) : pathologies chroniques et ou alimentaires ;
-
projet personnalisé de scolarisation (PPS) : situation de handicap ;
-
plan d’accompagnement personnalisé (PAP) : troubles des apprentissages ;
-
programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) : maitrise de certaines de compétences et connaissances.
En aucun cas, ces renseignements ne pourront préciser la nature du handicap ou de la pathologie. Les données ne sont communiquées qu’aux services de santé des élèves (médecins et infirmières scolaires). (source : https://www.education.gouv.fr/la-protection-des-eleves-et-de-leurs-donnees-sur-internet-7073)
[7] https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante
https://esante.gouv.fr/faq/quest-ce-que-la-donnee-de-sante

A propos de l’auteur :
Rémi Applanat est psychologue clinicien l’ARI est représentant syndical CGT ; il exerce le mandat de délégué syndical central supplémentaire.